Mais non, pas "Alexanderplatz", -39
Attention: j'ai copié-collé quelques textes trouvés sur la Toile à propos d'Alfred Doblin. On les reconnaît en italique. C'est parfois ennuyeux, bon...
Deuxième floraison.
Je les trouve affectueux et pleins d'humour.
Il suffirait d'inclure quelques dialogues.
C'est épouvantable. Dehors un brouillard noie le village. On n'entend que les cloches des vaches. J'allais écrire "on entend juste les cloches des vaches". L'utilisation qu'on fait aujourd'hui de ce "juste" m'énerve. M'enfin, vrai que nos amis anglo-saxons en abusent depuis longtemps.
Les oiseaux me tiennent compagnie. Sur la barrière ils ressemblent à des ombres.
Étrange: deux rosiers refleurissent !
L.T.
P.S.1.: Alfred Döblin. Non, le deuxième livre (prêté dimanche par un ami), le premier c'est le japonais avalé en un jour et une demi-nuit (j'aurais pas du). Le deuxième, ça n'est donc pas ce fameux "Alexanderplatz" (publié en 1929) mais le premier tome de "Novembre 1918, une révolution allemande"..c.à d. : "1.: Bourgeois et Soldats". Cette tétralogie fut publiée tranche par tranche, entre 1939 et 1978 dans sa version allemande.
Quatrième partie.
L’histoire est inspirée par l’expérience personnelle de Döblin en Alsace. De cette expérience Döblin d’abord tire un récit,Jours de révolution en Alsace, qui paraît dans la revue Die neue Rundschau (de) en février 1919. Döblin y dépeint la Révolution comme une joyeuse blague, un carnaval.
Ce premier tome traite des relations entre l’Allemagne et la Révolution, en confrontant plusieurs personnages de différentes positions sociales afin d’atteindre le plus d’objectivité possible ; une démarche qui sera poursuivie par Döblin dans les tomes suivants."
D'abord: qui s'intéresse à cette période de l'histoire (allemande ou plus) ? Des intellectuels, des chercheurs, des historiens, les anciennes générations et quelques curieux. Il m'arrive de douter de la jeunesse. Ça n'est pas une obligation que de s'informer des choses du XXeme siècle (ou d'autres siècles).
Quand je vivais heureux en mon village de Buoi (ah, il parait que les termites lancent une nouvelle attaque au deuxième étage de notre maisonnette), quand... nous parlions des Guerres indochinoise et "américaine", les amis de Dulcinée refusaient toute relecture ne s'en tenant qu'aux versions officielles... bien que par ailleurs ils n'accordassent aucun crédit à leurs dirigeants. C'était parfois tendu, même si je ne prenais pas la défense des Français et/ou des Américains.
Et, côté jeunesse, je n'ai jamais trouvé autre chose que l'ennui lorsque j'évoquais, par exemple avec le fils de Dulcinée, lorsque j'évoquais certains aspects de la douloureuse histoire du Vietnam.
- C'est aussi loin que tes Romains, me lança-t-il une ou deux fois.
Il faut comprendre cette réaction: l'enseignement de l'histoire a pour but premier la défense d'une idéologie communiste que chacun reconnaît comme pourrie mais personne ne peut dire qu'elle est pourrie. Alors à quoi bon en parler. Et on ne pose pas de questions à l'enseignant.
Ainsi donc.. à quoi bon lire, sinon parler, de cette période d'entre deux guerres (14-18 et 39-45) ? Certes Alfred Döblin a écrit (presque) en direct. La République de Weimar... malheureuse héritière de la défaite de 1918 et gestionnaire des humiliantes conditions imposées par les vainqueurs.
Un entre-deux-guerres extraordinairement créatif et inventif. Les artistes débordant d'imagination... en puisant toutes les folies esquissées par leurs prédécesseurs à la fin du XIXeme comme l'Art Nouveau.
L'Ankeruhr, horloge de cuivre et de bronze,
fabriquée par Franz Matschen 1911 domine le Hoher Markt à Vienne.
Alors, nostalgie d'un temps que nous n'avons pas vécu, transfert sournois d'une culpabilité collective ?
(En passant: la notion de "culpabilité collective" est une affaire appartenant spécifiquement à l'Europe occidentale, continentale. On peut imaginer que la responsabilité "positive" en revient à nos philosophes et à leurs enfants dégénérés que sont les psychanalystes. Cette "culpabilité" et nos efforts d'affranchissement sont des phénomènes quasiment incompréhensibles aux Amériques et en Asie. En Afrique cette culpabilité... et nos efforts d'affranchissement ont engendré un opportun sentiment d'oppression intellectuelle se manifestant encore aujourd'hui de manière irrationnelle et variée. On pourrait faire une exception sur ce sujet de la culpabilité en ce qui concerne le Canada et l'Océanie.
Plus haut je précise "Europe occidentale, continentale" considérant l'influence des théories de Darwin sur les opinions anglo-saxonnes, théories aux valeurs scientifiques déterminantes certes mais marquées par une dérive raciste. Les Britanniques n'ont pas de complexes "à la française".).
En renvoyant les horreurs du XXeme siècle aux calendes grecques et romaines notre jeunesse passe-t-elle aux oubliettes cet entre-deux-guerres ? Par exemple le premier film "parlé" (1923, qui n'est pas "Le chanteur de jazz"), la télévision *,...
* 1935 : Premières émissions en France sur 180 lignes. Le poste de Paris-Télévision comporte le studio rue de Grenelle, le poste émetteur HF., pilier sud de la Tour Eiffel et 4 antennes au sommet de la tour, alimentées par un feeder de 330 mètres de long. Le courant H.F., modulé par l'image, correspond à une. onde de 8 mètres (37,5 MGH),
La caméra de prise de vue est un simple disque de Nipkow à double spirale tournant à 50t/s. l'obturation périodique d'une spirale étant assurée par un second disque. Les disques tournent en l'air à la différence des appareils allemands, de cette époque dont les roues sont dans le vide, évitant le bouchage des trous par les poussières.
Les émissions de 1935, assurées par le service de P.T.T., sont remarquables en deux points:
1/ la réfrigération du studio.
2/ la prouesse technique du câble feeder. L'éclairage total de la scène atteignait en effet une puissance de 48OOOwatts avec dissipation de chaleur gênante et même dangereuse' pour les artistes . Un conditionnement d'air (température et humidité) bien conçu résolvait pour l' avenir cet inconvénient.
La première installation comportait un récepteur de contrôle au pied de la tour et l'émetteur .fonctionnait avec 2 kw. distribués par quatre doublets verticaux aux angles de la tour.
Dès 1935, un poste plus puissant est en construction au pilier Nord pouvant fournir aux antennes une puissance de 10 kw. Histoire de la Télévision - NordMag.
- Tu t'es perdu, Mon Papounet ?
- Non, pas vraiment. Weimar c'est l'entre-deux-guerres.
** Hommage à Döblin
Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage à Alfred Döblin, à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort. Cinquante ans, c’est un délai raisonnable pour redécouvrir un auteur, mais, dans le cas de Döblin, à vrai dire, il ne s’agit pas de redécouverte. Non qu’il aurait occupé pendant toutes ces années le devant de la scène, c’est plutôt qu’il n’y est jamais réellement monté. Je force à peine le trait en disant que son œuvre reste à découvrir. En dehors du cercle étroit des spécialistes, que sait-on en France – et, sans doute, pourrais-je dire, en Allemagne – d’Alfred Döblin écrivain ? Bien sûr, son nom est accolé à Berlin Alexanderplatz, roman classé parfois par une critique paresseuse ou malveillante dans la série des romans interlopes ; ou, plus sérieusement, rangé, à cause des techniques du montage et du collage qui y sont mises en œuvre, à côté d’_Ulysse_ de Joyce ou des romans de Dos Passos, parmi les grands textes de la modernité ; cela est considérable, évidemment, mais n’épuise pas une œuvre qui ne se résume pas à cette seule formule, loin s’en faut. En France, la renommée de Thomas Mann, ou bien la gloire indue d’un Ernst Jünger, pour ne citer que les écrivains allemands de la même génération canonisés chez nous, excèdent infiniment la trop modeste reconnaissance dont Döblin bénéficie. [Lui qui n’a jamais eu la moindre complaisance pour le nationalisme et le fascisme allemands, qui s’est réfugié en France, qui a acquis la nationalité française, s’est vu jusqu’ici trop peu reconnu, en tant qu’écrivain, par son pays d’adoption.] Cette cérémonie vient donc à point nommé.
La raison du décalage entre l’accueil et l’importance réelle de cette œuvre vient de loin et n’a guère changé au cours des décennies : c’est que Döblin est lui-même, justement, un auteur en décalage, je veux dire par là qu’il n’a jamais cessé de tromper les attentes ordinaires, esthétiques, idéologiques, politiques, du lectorat et de la critique. Ce n’est pas qu’il soit mu par une volonté de scandale, de celle qui tente de pallier l’absence réelle de talent par l’excentricité, comme l’histoire de l’art et de la littérature en offre parfois l’exemple. Il y a bien sûr chez lui un goût de la provocation, mais c’est une insolence salutaire, qui naît de l’aversion pour la médiocrité, quand elle tient le haut du pavé ou prétend régir le travail de l’écrivain. La méfiance à l’égard de Döblin est consubstantielle à son génie propre et à l’idée particulière, et particulièrement haute, qu’il se fait de la littérature. Car la littérature n’est pas pour lui un divertissement, un jeu gratuit, elle ne se donne pas non plus pour rôle de fournir des leçons de morale, ou de faire de l’agitation politique, elle n’est pas non plus le lieu « où l’auteur malheureux vide son cœur », un « cabinet pour exhibitionnistes, un WC littéraire », comme il le dit plaisamment, et comme c’est tellement à la mode aujourd’hui. La littérature est pour lui une « manière de penser », et l’auteur de fictions est « une espèce particulière de savant ». Il est cet explorateur infatigable dont la tâche est de s’interroger sur l’homme, sur la nature, sur l’histoire, et sur l’homme dans l’histoire. Et qui, comme romancier, doit le faire avec des moyens spécifiques : une certaine disposition non utilitaire du langage, un jeu souverain avec les éléments de la réalité, une confiance totale dans les pouvoirs de l’imagination. Pas n’importe quelle imagination, cependant. Car, de même, dit-il, que « les auteurs se distinguent en veilleurs et en endormis [ou] flottant dans les nuages », de même « il existe une imagination exacte et une imagination inexacte. […] La littérature suppose un regard anormalement aigu et un sens pour la vérité de la science. Sans un grand investissement de l’esprit, la littérature n’est pas possible. L’activité littéraire exige un regard très aigu sur la réalité. Avant de chanter, Homère avait ce regard aigu ».
On comprend qu’une ambition aussi haute lui ait interdit de confondre jamais l’activité littéraire avec un plan de carrière, et que sa vie durant il ait dédaigné de travailler à sa gloire, comme d’autres l’ont fait ; lui qui, jusqu’à ce que les nazis le chassent, est resté médecin dans les quartiers pauvres de Berlin, et qui a tiré de cette activité ce rapport familier et lucide avec la réalité sociale et la réalité allemande ; on comprend aussi que son exigence entre en collision avec ceux, écrivains et critiques, qui entendent parquer la littérature dans la sphère étroite de l’esthétisme, de ce que Döblin appelle plaisamment, en allemand, le « Kunst-Kunst » ; y compris quand celui-ci porte le nom d’avant-garde, d’où ses polémiques avec l’expressionnisme, auquel on l’identifie trop souvent. Mais on comprend aussi qu’il ait refusé toute sa vie d’asservir la littérature sous quelque dogme, esthétique ou politique, et pour quelque tâche partisane que ce soit, ce qui l’engagea, avant guerre en Allemagne, puis en exil, et après—guerre encore, dans de vives polémiques avec les tenants du réalisme socialiste, mais ce qui lui valut aussi une grande indifférence, de l’ignorance et du mépris, de l’autre côté, dans la RFA d’après-guerre, avec à la clef un traitement éditorial désinvolte, quand il n’était pas tout simplement indigne.
La littérature döblinienne ne se laisse pas enrôler. Mais le gain de cette liberté obstinément revendiquée est immense. Écrit contre la routine romanesque, [avec ses intrigues bien ficelées et ses personnages corsetés dans des rôles prévisibles], un roman döblinien [rebaptisé « œuvre épique »] est une aventure unique et surprenante, qui ouvre sur le « monde magnifique, sans entrave, de la libre fabulation ». Il abandonne les boudoirs, les salons bourgeois et les maisons patriciennes, largue les amarres, prend le large, pour s’en aller dans des contrées lointaines et exotiques, au fin fond de la Chine ou de la forêt amazonienne, et plus loin encore et plus haut, jusque dans les étoiles, dans le passé aussi, au cœur des tourmentes et des tourments de la Guerre de Trente ans, ou bien au contraire très loin en avant de nous, dans les siècles et les apocalypses à venir. Il y a du Hugo chez cet homme-là, dans cette conjonction d’un imaginaire du temps et de l’espace et d’un imaginaire d’événements parfois extravagants et énormes, cimentés par la langue, cette « force productive », une « langue vivante » qui n’a rien à voir avec la langue léchée, polie et policée des grands stylistes patentés. Ces romans-continents sont des livres d’accumulation de mots, d’invention langagière inouïe, qui font de Döblin le prosateur allemand le plus inventif du début du siècle dernier [et qui, en France, attendent encore leurs traducteurs]. Mais un roman de Döblin, ce peut être aussi un voyage au plus près du contemporain, de la réalité allemande, et du parler populaire. C’est assurément une nouveauté radicale pour le roman allemand d’accueillir le peuple comme il est fait dans Berlin Alexanderplatz, et de faire de la grande ville moderne, contre toute la littérature réactionnaire de terroir, non plus seulement un décor, mais un acteur qui parle.
Conjuguant le plaisir de raconter et les expérimentations de la modernité, s’abandonnant tantôt au simple récit et tantôt inventant les structures narratives les plus complexes, accueillant les parlers populaires mais sachant exploiter aussi toutes les ressources poétiques de la langue allemande, introduisant dans le roman les régimes textuels les plus divers, du document brut jusqu’au poème en prose, abolissant les frontières entre le haut et le bas, le tragique et le comique, et s’ouvrant à toutes les formes du rire, de l’ironie la plus sophistiquée au burlesque le plus débridé, l’œuvre romanesque d’Alfred Döblin est d’une ampleur, d’une variété et d’une inventivité incomparables. C’est dire aussi qu’il n’y a pas un style döblinien, pas plus qu’il n’existe un style de Picasso, mais des styles. Je disais qu’il y a du Hugo chez Döblin, il y a aussi du Picasso, en ce sens qu’il ne s’est jamais accommodé du confort de la répétition. Mais s’il y a des styles, et si chaque livre possède une figure singulière, il y a bien, au bout du compte, une tâche unique : comprendre le monde, l’homme dans le monde et dans l’histoire. Contrairement à ces auteurs qu’il poursuit de ses sarcasmes, Döblin ne s’évade jamais dans une métaphysique de pacotille – ce qu’il appelle le « court-circuit dans le mysticisme » –, même si, au terme d’un processus intimement noué à son travail d’écriture, et sous l’effet conjugué des catastrophes historiques et personnelles, il finit par considérer que le destin de l’homme ne se situe plus exclusivement dans le cadre de l’histoire et s’il se convertit vers la fin de sa vie à la religion catholique. Il n’est cependant guère d’auteur allemand de la première moitié du XXe siècle qui se soit colleté plus près, avec autant de pugnacité et de véhémence, d’indignation et de vigueur dénonciatrice, autant de clairvoyance aussi, avec la réalité historique et en particulier avec ce qui réchauffait de longue main le ventre d’où est sortie la bête (pour parler comme Brecht) ; c’est le thème majeur de son roman Novembre 1918 – un « monument unique », selon ce même Brecht. Il n’en est pas un non plus qui ait avec autant d’obstination que lui, dans chacun de ses livres, y compris dans ceux qui semblent le plus éloigné des préoccupations contemporaines, expérimenté des solutions, cherché des réponses à la question qu’en tant qu’humaniste il n’a jamais cessé de poser et de se poser : comment rendre la société des hommes plus humaine ? plus accueillante à l’individu ? Et comment empêcher le triomphe constant des puissants sur les faibles ? [Enfin, il n’en est pas, me semble-t—il, qui ait su mieux que lui faire surgir la confrontation entre l’histoire et le monde social sur les questions touchant aux relations entre les êtres et affectant leur vie au plus intime, rendant si caduc le clivage ordinaire entre réalisme social et réalisme psychologique.]
La grandeur de l’écrivain Döblin, c’est cela : la mobilisation d’un regard aigu sur le monde, d’une dextérité langagière incomparable, d’une inépuisable ressource fabulatoire, aux fins de tester des réponses aux défis d’un siècle monstrueux à bien des égards. « Pour des raisons liées à leur science, [les écrivains] ont davantage accès à la réalité et accès à davantage de réalité que beaucoup d’autres, qui ont pour seule réalité leur petit peu de politique, d’affairisme et d’action », écrit Döblin. C’est là la meilleure défense et illustration de son œuvre. Quelques-uns de ses pairs ne s’y sont pas trompés, ni Apollinaire, ni Brecht, qui a dit à plusieurs reprises sa dette et dont le « théâtre épique » n’existerait peut-être pas sans les impulsions fournies par la lecture des essais théoriques et des œuvres de Döblin ; ni, plus près de nous, Grass, voyant en Döblin son maître. Ce sont là, je pense, des cautions suffisantes pour que l’on considère enfin que Döblin n’est pas un écrivain allemand parmi d’autres, mais, pour reprendre les mots de Gottfried Benn, « un écrivain gigantesque, [qui], avec le seul petit doigt de sa main droite, en fait plus que la plupart des autres romanciers ».
Michel Vanoosthuyse
Salons de l’Hôtel de Ville de Paris
le 30 octobre 2007
Bourgeois et soldats
Le premier volume de ce monumental roman d’Alfred Döblin sur la révolution allemande de novembre 1918 raconte les deux premières semaines qui suivirent la déclaration de la République de Weimar. Le premier chapitre est intitulé : « Dimanche 10 novembre 1918 ». La guerre est terminée, mais les souffrances perdurent. Qu’est-ce qui a changé après le désastre causé par les hommes ? Au centre de la trame, le lieutenant Friedrich Becker, dans le civil professeur de langues anciennes dans un lycée classique, est revenu de guerre avec de graves blessures physiques et psychologiques : « … je ferais mieux de me coucher dans un cercueil !». Profondément ébranlé par les horreurs vécues pendant la guerre, Becker se torture, lui et ses congénères, par des reproches. Tout tourne autour des questions pour lui existentielles que sont la culpabilité et la responsabilité personnelles et l’espoir de trouver, quand même, la « véritable paix ». Désespéré, le « pauvre bougre » cherche réconfort dans la foi chrétienne ; il se renferme de plus en plus sur lui-même ; perd son emploi de professeur qu’il vient de reprendre et même, pour finir, sa bien-aimée. Mais il ne parvient pas à se débarrasser des multiples « démons » du monde des esprits. Becker est torturé par des remords ; il proteste sans succès contre des injustices manifestes et tente vainement de se suicider. Advient ce qui devait advenir dans de telles circonstances : le moralisateur désespérément épuisé est envahi par l’horreur de tout ce qu’il voit (arriver) :
«… c’est un mauvais esprit qui a créé cette vie. J’étais mort, et sans connaître la volupté suprême, comme dans ‘ Tristan’, c’était du moins le calme, le repos, un état vrai et convenable. Un mauvais esprit, alors, m’a réveillé, c’est que l’on appelle guérir. Il me faudra chercher en vain le repos, attendre, espérer, désirer sans jamais me relever. Il est mauvais, et je traque sans jamais m’accorder un instant de répit. Voilà ce que nous avons reçu, voilà ce qu’on nous a octroyé : cette folie. »
Jusqu’à la fin des années 1920, l’homme brisé se traîne à travers l’empire allemand, tel un « souvenir vivant de la dernière guerre ». Depuis longtemps catapulté hors de l’ordre humain, cet homme solitaire issu d’une autre époque vise désormais à faire taire les murmures du diable dans son oreille, à se détruire lui-même. Finalement, il sera consciemment victime d’un crime brutal que des procédés littéraires enjoliveront en acte de délivrance. Friedrich Becker semble avoir subi une sorte de « révolution intérieure » (Gabriel Sander) ou de catharsis.
Au pourfendeur désespéré « de l’humain et du divin » Döblin oppose l’écrivain Erwin Stauffer, personnage ambigu, toujours en quête de nouvelles aventures amoureuses : ce bourgeois cultivé, conservateur et d’un égocentrisme théâtral, se dit apolitique, mais nourrit des envies métaphysiques. Homme fat, toujours très élégant, Stauffer est un auteur dramatique et nouvelliste qui traite surtout des sujets « d’inspiration médiévale, voire allégorique », compose parfois des « poèmes finement ciselés », d’où l’admiration dont il continue à être l’objet après la guerre. Cependant, ce monsieur enrobé souffre, notamment d’une crise créatrice sévère. Notre narrateur moqueur fait de lui, avec une ironie marquée, l’expression intérieure de l’existence trouble de l’ancien utopiste dans sa tour d’ivoire. En effet, à chaque fois qu’il doit prendre clairement position, Stauffer se réfugie dans des phrases intemporelles qui n’engagent à rien. Faux intellectuel qui aime fuir les réalités embarrassantes, il se réfugie dans les citations faciles ou les métaphores grandiloquentes telles que « Je les laisse à leurs affaires. On appelle bien cela désertion. Finalement je suis aussi de ce crû. Lénine et Wilson, nos frères d’esprit. Je pensais aussi quelquefois que je devrais me mettre en rapport avec le peuple, avec les masses. » Cependant, tout cela est un jeu de l’esprit. Stauffer n’a qu’un doux sourire pour les révolutionnaires. Il s’est prescrit l’extase d’une « mort triomphale à Babylone » et ne reste fidèle qu’à l’éternel féminin : « Il lui faut au moins ça. »
Il faut voir dans son indifférence pour les affaires politiques, avec l’obstination, la sottise et de la paresse de la nature humaine, un autre aspect du début de la fin fatale de l’histoire des idées en Allemagne. Les antagonistes mis en lumière ici ne représentent toutefois que deux catégories humaines pour toutes les autres dont le psychogramme compose le puzzle fascinant du récit : « En conséquence, nous prierons certains de ces hauts personnages de se dépouiller un instant de leur accoutrement monstrueux et d’évoluer librement devant nous ; ils y gagneront en diversité et nous les verrons défiler méchants et complaisants, fourbes et charmants, tendres et insatiables ». Le lecteur reste sur le qui-vive ; il lui manque toujours un aspect des choses.
P.S.2.: Je planche comm'on dit, dessinant ou plutôt traçant des lignes (au crayon) sur mes bois. Il me vient une drôle idée. En construire deux... successivement, c'est à dire que je me servirai d'une première ébauche pour éviter trop d'erreurs sur la deuxième. Par "erreurs" il faut comprendre improvisation.
P.S.3.: En vieillissant, et quelles que soient nos résistances, il arrive qu'on sente la page d'un chapitre qui se tourne. La page se tourne, don, pas le chapitre. C'est ce qui m'arrive ces jours. Peut-être est-ce un effet collatéral de l'absence de Dulcinée. Elle me "rabroue" souvent ce qui m'oblige à réagir.
Bien, allons ramasser la lessive qui aura fini de sécher malgré l'humidité ambiante.
Depuis le départ de Dulcinée pour Hanoi, j'ouvre grand les fenêtres et les portes du balcon. Maintenant il fait un "14 dégrés" à l'intérieur de notre logement. J'aime ce froid et des habits chauds me protègent. C'est vrai, parfois je me fume une pipe, n'en parlez pas à Dulcinée, oh, sans doute elle s'en doute.
Oui, ces signaux du vieillissement qu'il faut "regarder d'une oreille distraite et d'une autre attentive". Oui, les oreilles savent "regarder", simple.... observer un chat si vous en doutez, gens de peu de foi, ces signaux sont multiples.
Tiens, dimanche lors de cet agréable diner (repas de midi en Suisse) talentueusement préparé par cet ami, sans oublier le Paris-Brest (de la pâtisserie de Blonay, Bienvenue Chez Yan | Boulangerie, pâtisserie, confiserie | Blonay | ?).
- Papy !!!
- Patience ma Juju. Oui. Cet ami cuisinait, son épouse, cette amie de plus de 50 ans, je veux dire que nous nous connaissons depuis plus de 50 ans, donc évidemment elle a plus de 50 ans, cette amie parlait de quelques réunions auxquelles elle participe régulièrement, réunions ayant comme sujet la philosophie. Deleuze (Gilles Deleuze (Stanford Encyclopedia of Philosophy) - Stanford University). Et elle en vint à parler de fonctif, immanence et percept. Enfin moi j'écoutais parce que de ces mots je ne sais rien dire. En supposer le sens. Oui. Vaguement. Si je n'ai pas trop de peine (souffrance) je peine (j'ai de la difficulté) à la suivre. Pas tant le "meaning", la signification, mais dans cette sorte de nécessité d'utiliser des mots trop éloignés du langage populaire.
Simplex simplicissimus. Les Aventures de Simplicius Simplicissimus — Wikipédia
Dans un ouvrage littéraire, un roman par exemple, je comprends que des auteurs puissent "se servir" d'un vocabulaire pointu, comme Victor Hugo dans "Notre Dame de Paris.1482". L'architecture de la Cathédrale jouant un rôle majeur. On retrouve pareil souci chez de nombreux écrivains "provinciaux", "La Jument verte" de Marcel A., "La Femme du. Boulanger" de Marcel P.... romans populaires.
- Bref, O Mon Papy ! Chauffe Marcel.
- Même ce grand illusionniste de Zola l'avait compris dans son Germinal, lui qui pourtant ne descendit qu'une fois au fond d'une mine de charbon. Alors pourquoi les philosophes et leurs sous-produits dégénérés (les psychanalystes... à ne pas confondre avec les psychiatres, eux médecins), pourquoi les philosophes de nos ères se sentent-ils obligés de parler "chinois"? Autre question: quels sont les liens (je dis bien "liens") qui attachent ces gens au langage et plus spécifiquement quel est l'importance de la langue de réflexion ? Français, allemand,...
Durant la messe, nos prêtres, au moment de la consécration, disent : "Prenez et mangez en tous ceci est mon corps et mon sang..." .Personne ne parle de "transsubstantiation" . Et quand c'est fini et que le prêtre nous renvoie à la maison, ite missa est, au nom du père, du fils et du saint esprit... personne ne pense : consubstantialité ! Je suspecte depuis longtemps, sinon toujours, ces braves philosophes, probablement sincères, de vouloir essayer de vendre leurs déconnages comme du travail scientifique. Rien est scientifique en philosophie. Les Grecs se taperaient sur les cuisses (l'un l'autre) en entendant parler de Docteur en Philosophie.
Comment les sourds-muets "signent"-ils leur cogitation philosophique ? Autrement dit: peut-on philosopher sans utiliser le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ?
- Mes Chères, Chers, mes Aimées, Aimés, O Mes frères et sœurs humains, ah p'is même mes ennemis, avant de m'oublier..., ce que je vous recommande sans vous commander, voyez comme je me régale de la vie.
- Non !
- Et pour le cul, le sexe..., la tendresse ce fut aussi bon...
Lors de ce repas, cette précieuse amie m'a quand même remonté les bretelles (gave me a real dressing-up). Je la connais assez (plus de 50 ans, don) elle le faisait sciemment. Nous parlions de mes ecriturailleries. Mon refus d'exposer ce que j'ai écrit à des gens du métier.
Si je continue de penser que mon "Momoh van Brugge" et mon "Trieste" sont "bons", si je choisis de continuer à écrire en secret, je n'attends rien d'un lecteur. Qu'il, elle lise Alfred Doblin ou Abe Kazushige. Mais elle a raison, j'ai cessé d'aimer ce monde, enfin ce XXIeme siècle.
- Wouahhhh. C'est terrible, O Mon Papy.
- Je t'aime toi ma Juju...
- Où tu iras j'irai, où tu resteras je resterai, où tu dormiras je dormirai...Daddy ? T'es encore bourré ?
- 20%...
...











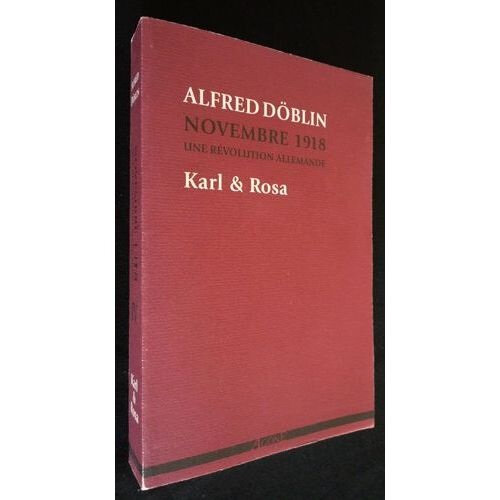








/image%2F1370655%2F20240503%2Fob_9b26a7_105189121-o.jpg)
/image%2F1370655%2F20240501%2Fob_df78ae_102825125.jpg)
/image%2F1370655%2F20240430%2Fob_780458_105016087.jpg)
/image%2F1370655%2F20240429%2Fob_c68130_103387053.jpg)